Alors que les Rencontres nationales art et essai Cannes 2025 viennent de débuter, rencontre avec Guillaume Bachy, président de l’Association française des cinémas art et essai (Afcae), pour évoquer les 70 ans d’un mouvement fort de sa maturité, et qui mise plus que jamais sur la jeunesse !
Quelles sont les ambitions majeures de ces Rencontres nationales cannoises, marquées par le 70e anniversaire de l’Afcae?
L’ambition première est de lancer une année de célébration constructive, fruit du travail de toute notre équipe. Au-delà de cet événement qui revêt une importance particulière, nous souhaitons initier une réflexion collective pour moderniser l’image de notre mouvement. Pendant toute cette année d’anniversaire, de mai 2025 à mai 2026, nous mettrons tout en œuvre, à travers nos 1 250 salles, leurs événements et nos outils, pour redonner un nouvel éclat à l’art et essai.
À lire aussi │Rencontres nationales art et essai Cannes 2025 : le programme complet
Vous parlez “d’éclat” ; quelles évolutions souhaitez vous accompagner ?
Si la terminologie même de l’art et essai date de 1955, nous voulons montrer qu’elle n’est pas poussiéreuse et qu’elle incarne la modernité. Elle évoque la proximité et le respect que nos salles entretiennent avec leurs spectateurs, la qualité des films que nous défendons, la richesse de nos actions culturelles, ainsi que la convivialité et les échanges qui y naissent. Les salles art et essai sont devenues de rares espaces où des collectifs de spectateurs, qui ne se connaissaient pas, se rencontrent et dialoguent après la projection d’un film, parce qu’il y a un débat ou un cinéaste. Ce sont des lieux de rencontres, de voir et de vivre ensemble.
Les gens le savent, mais ont peut-être une vision déformée ou un peu élitiste de la salle art et essai. Nous voulons leur dire que quand ils vont voir Vingt dieux ou En fanfare, ils font déjà partie de la grande famille du mouvement art et essai. Quand on pousse la porte de nos établissements, on est reconnu, entendu, considéré. Et quand un spectateur vient voir un film, il s’inscrit dans une dynamique ou une réflexion qui est déjà la sienne, sans percevoir forcément qu’il la partage avec la salle. Cette question du choix, d’une programmation éditorialisée et assumée, est propre à la salle art et essai : c’est un espace où on propose une interaction au spectateur.
L’interaction existe aussi entre les salles art et essai : nous souhaitons également valoriser l’appartenance de chaque salle à ce réseau national de 1 250 cinémas. Chaque salle est indépendante, avec son identité propre, mais toutes partagent des valeurs communes, forgées depuis 70 ans, qui constituent notre force et font aujourd’hui le ciment qui nous lie.
Au-delà de la communication, comment comptez-vous concrètement accompagner les salles dans cette nouvelle dynamique ?
Nous travaillons depuis deux ans sur cette question des valeurs, pour s’interroger avec les adhérents sur ce qu’est une salle art et essai. Aujourd’hui, nous devons mener un travail très opérationnel pour que les salles se reconnaissent dans ces éléments de langage, qu’elles s’en emparent et les portent auprès de leurs spectateurs, à l’image des courtes vidéos de présentation dans lesquelles elles expliquent leur démarche art et essai, leurs choix de programmation, leur identité et le rapport qu’elles entretiennent avec leurs publics… Cette démarche est déjà une réussite, qui a permis aux salles de se fédérer, se poser et réfléchir aux valeurs de l’art et essai avec leurs collaborateurs ou leurs bénévoles, ce qu’elles n’ont pas le temps de faire au quotidien.
À lire aussi │ Notre dossier spécial « 70 ans de l’Acfae » dans le Boxoffice Pro du 11 mai 2025
Quels sont les principaux atouts qui ont permis à l’Afcae de s’adapter pendant ces sept décennies ?
Notre mouvement a toujours été force proposition et s’est constamment renouvelé, à l’instar de la salle de cinéma qui porte l’innovation dans son ADN. Dans toute notre histoire, nous avons lancé des initiatives, comme celle de travailler sur le public des 15-25 ans. D’ailleurs, toutes nos bonnes idées sont reprises et, en cela, valorisées. L’Afcae a en effet cette chance d’avoir un double lien. Le lien artistique, à travers le soutien aux films, aux auteurs et à nos actions culturelles, et en parallèle, le lien aux collectivités, au CNC, au ministère de la Culture, et même au Parlement européen, à travers notre travail d’ordre politique, pour que la parole des salles que nous défendons soit entendue. Cela a été le cas lors de la réforme art et essai annoncée l’année dernière. Nous avons toujours fonctionné sur ces deux jambes qui nous permettent d’apporter une vraie stabilité à nos adhérents.
Vous évoquez la réforme art et essai : quels premiers enseignements peut-on en tirer ?
Les propositions que nous avions émises ont globalement été entendues. L’augmentation du nombre de commissions régionales a permis un examen plus attentif des dossiers, tout en contribuant à une meilleure prise en compte des actions culturelles et des animations. La partie consacrée à l’animation est perfectible, mais elle permet d’évaluer les barèmes de points attribués aux salles. À ce stade, aucune typologie ne semble faire l’objet d’un traitement privilégié. Nous avions exprimé une vigilance particulière quant au soutien apporté aux catégories D et E ; il apparaît qu’elles bénéficient, dans bien des cas, d’une attention renforcée. Des baisses de subvention ont toutefois été constatées, comme nous l’avions anticipé. Elles concernent principalement des salles ayant diffusé moins de films art et essai ou dont les animations ont été moins soutenues cette année.
Dans cette configuration, l’enveloppe consacrée à l’art et essai sera-t-elle suffisante ?
Toute la difficulté est de répartir au mieux l’enveloppe globale. La réforme ne devrait pas empêcher un nouvel écrêtement, l’enveloppe étant insuffisante au regard du travail qualitatif mis en place par les salles. Nous demandons donc au CNC d’abonder l’enveloppe art et essai, qui reste quand même basse par rapport au nombre de spectateurs et au nombre de salles concernés, soit 19 millions d’euros pour près de 1 300 cinémas et 43 millions de spectateurs en 2024. C’est peut-être l’outil de politique culturelle le plus rentable qui existe.
Notre demande est donc la même que l’année dernière, c’est-à-dire 21 millions d’euros. Par ailleurs, l’Afcae n’était pas d’accord avec la minoration des films, qui aura un impact très dur pour certaines salles l’année prochaine. Le classement art et essai relève d’une politique culturelle incitative, qui encourage à développer les actions et la diffusion. Les salles font ce travail et nous espérons qu’il sera reconnu. Pour le nouveau président du CNC, ce serait un geste fort, corollaire à tout le discours qui est porté par le ministère sur l’accès à la culture partout et pour tous.
L’éducation aux images est toujours au centre des préoccupations de la filière. Quelles sont vos réflexions alors que les ministères de l’Éducation et de la Culture ont commandé une étude à Edouard Geffray ?
Il faut réaffirmer l’importance des dispositifs scolaires. Ce sont les seuls dispositifs d’éducation à la culture qui fonctionnent au niveau national, coordonnés, réfléchis et sur lesquels enseignants, parents, enfants, exploitants, peuvent s’appuyer. C’est une excellence à la française : les films sont choisis et suscitent un vrai travail de lecture de l’image, ce qui est absolument indispensable. Pour autant, nous devons réinterroger ces dispositifs, sur le choix des films d’une part et sur la formation des enseignants et des exploitants d’autre part. Il ne faut pas perdre de vue ce que doit être le dispositif en salle : un accueil différencié, une présentation et un accompagnement. C’est là que le pass Culture peut entrer en jeu. Il ne doit pas remplacer les dispositifs mais les enrichir par des actions culturelles, comme un tournage ou des rencontres avec différents métiers du cinéma. C’était la promesse initiale. L’année dernière, nous avons tiré la sonnette d’alarme sur le mode de gestion à la demande du pass Culture, en appelant à plus de justice et d’équilibre, via la mise en place d’un encadrement tarifaire et en s’assurant que les séances relevant de la part collective portent sur des films art et essai. Que s’est-il passé trois mois plus tard ? Le gel brutal de la part collective et une diminution drastique de la part individuelle. Nous avions prévenu, maintenant nous demandons à être entendus. Nous attendons beaucoup de la mission confiée à Edouard Geffray sur les dispositifs Ma classe au cinéma, qui devrait apporter des solutions pour la rentrée prochaine. Nous avons porté la voix des salles pour plus de reconnaissance, pour le maintien d’un parcours d’excellence, mais aussi la possibilité pour les enseignants de s’investir dans des formes plus légères et progressives.
Quelles sont vos inquiétudes sur les coupes budgétaires territoriales actuelles ?
La baisse des subventions des collectivités est une vraie problématique cette année. Certaines font des coupes pour des raisons réellement budgétaires, d’autres pour des raisons politiques et punitives. C’est un désaveu de la culture : les festivals, les associations, les structures de médiation sont impactés. Le groupe des associations territoriales de l’Afcae a recensé de nombreuses associations touchées par ces baisses. Et si les salles ne sont pas directement impactées cette année, elles le seront l’année prochaine. Cette iniquité entre les territoires créera des injustices entre les salles, qui seront visibles dans les dossiers de classement art et essai. Nous devons tirer un signal d’alarme face à cette délégitimation de la parole culturelle : le maillage territorial dont tout le monde était si fier il y a quelques années peut très vite se détricoter. Nous sommes convaincus, comme d’autres acteurs du spectacle vivant ou de l’édition, que le lien entre le citoyen et le lieu culturel permet un meilleur vivre ensemble. À un an des municipales et deux des présidentielles, ce qui se joue est évidemment économique, mais éminemment politique.
Concernant les difficultés actuelles des salles, quelle est votre position concernant la réforme du fonds de soutien automatique ?
Toutes les salles sont en difficulté – d’autant plus après ce premier trimestre catastrophique – et le discours victimaire de certains ne peut plus passer aujourd’hui. On peut reconnaître et entendre les difficultés de la grande exploitation, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l’ensemble de la filière. Nous sommes très vigilants sur la santé de toutes les salles. Si celles de la petite et de la moyenne exploitation ne perdent pas suite à la modification du barème du fond de soutien automatique, d’autres combats restent à mener pour plus de justice. Les petites salles ont plus de mal à se saisir de ce fonds de soutien que la grande exploitation, car elles sont obligées de thésauriser et, parfois, d’attendre plusieurs années avant de mener un projet. On n’est pas du tout sur la même capacité d’intervention. Nous allons donc continuer à mener des actions régulières de formation et d’accompagnement auprès de nos adhérents, comme nous l‘avons déjà fait pendant la Covid.
Au sortir du Congrès de la FNCF, vous aviez alerté sur les tensions en matière de programmation des films. Qu’en est-il des engagements de programmation et de diffusion ?
Ces tensions sont exacerbées à cause du manque de films porteurs. De grands circuits cherchent à amortir leurs écrans en programmant des films art et essai, ce qu’ils faisaient très peu auparavant, engendrant une augmentation du nombre de copies en sortie nationale de ces titres. Non seulement il y a une dilution des entrées, mais les salles historiques art et essai rencontrent de vraies et nouvelles difficultés d’accès aux films. Ce que nous proposons, c’est que le caractère d’antériorité d’une salle puisse encore plus jouer au moment où elle fait une demande auprès du distributeur et de la médiatrice. Il n’est pas normal qu’une salle qui travaille les films art et essai depuis des années se retrouve au même niveau qu’une autre qui démarre ce travail parce qu’elle manque de films porteurs.
À lire aussi │Nouvelles lignes pour les engagements de programmation
Nous avons eu des échanges très constructifs et apaisés avec le CNC et les distributeurs. Tous partagent une volonté sincère de trouver des solutions par le biais d’une concertation globale. Les discussions ont convergé sur un point essentiel : la nécessité de considérer conjointement, et sans les opposer, les questions du nombre de copies et de séances, et celles de l’accès aux salles et aux films. Ces aspects sont intrinsèquement liés et le rôle de régulateur du CNC est crucial. Nous demandons à ce que les engagements de programmation – ce qui nous semble une évidence – soient territorialisés, car ils concernent un cinéma par rapport à sa zone de concurrence et non pas par rapport à l’ensemble de son circuit ou son entente de programmation. Les salles en monopole doivent pouvoir proposer à la fois une programmation généraliste et art et essai, mais on ne doit pas les obliger à prendre des films qui vont faire du mal à la salle historique d’art à essai d’à côté. La base de notre travail, aujourd’hui, est l’inscription d’un lieu dans un territoire.
Concernant les engagements de diffusion, tous les acteurs, y compris les distributeurs, sont en recherche d’un cadre. La comparaison qui revient le plus souvent pour décrire les situations actuelles est celle du “Far West”. Il faut saisir ce temps de relative stabilité politique pour prendre des décisions importantes, sans cela, comme dans les westerns, il y aura des victimes.
À lire aussi │Le Médiateur du cinéma présente son rapport 2024
Comment imaginez-vous l’Afcae et la représentation de la salle art et essai dans dix ans ?
Nous continuerons d’accompagner au mieux les films, les adhérents et les publics, tout en modernisant et réinventant nos outils et nos soutiens. L’idée, ce n’est pas de faire du « copier-coller » de ce qui existe déjà, mais bien d’inventer des accompagnements qui nous ressemblent, en restant fidèles à la diversité de l’Association. L’Afcae s’est construite à partir de cinq salles parisiennes indépendantes et privées, en 1955. Aujourd’hui, nous sommes 1 250 cinémas, privés, associatifs, municipaux, avec beaucoup ou peu d’écrans, avec des salariés ou des bénévoles. Cette diversité nous permet de percevoir les salles dans la totalité du maillage territorial, sans opposer les unes aux autres, et de parler à différents niveaux avec une vraie représentativité. Le but de notre travail aujourd’hui, c’est qu’une salle art et essai revendique son appartenance au mouvement de façon volontariste et que le spectateur entre dans une salle art et essai où il sera à sa place, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne, dans une démarche qui dépasse celle du consommateur. Si dans dix ans, on a réussi à changer ça, honnêtement, je pense que nous aurons gagné le pari que nous faisons aujourd’hui.


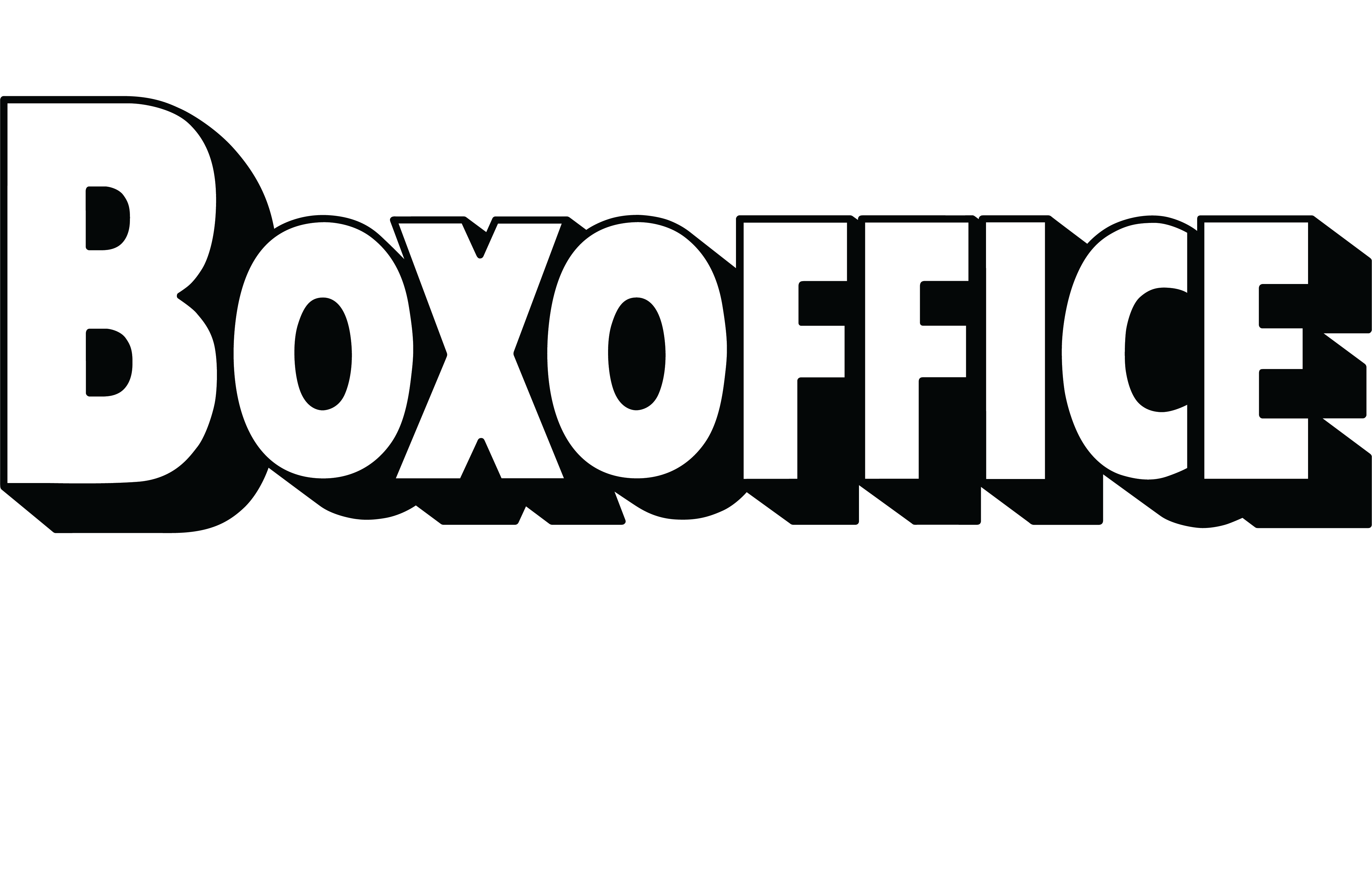
Partager cet article