Dans son rapport, la Cour pointe le modèle économique de l’institution cinéphile et propose de revoir ses statuts et sa gouvernance, en l’adossant davantage – voire en l’intégrant – au CNC. Dans l’idée d’ouvrir « une nouvelle page de son histoire ».
« La Cinémathèque est incontestablement une institution de renommée internationale, dépositaire de collections remarquables du patrimoine cinématographique, et elle a su agréger des compétences rares dans son domaine », a introduit le président de la Cour des comptes en présentant le rapport sur l’historique structure, pour rappel créée en 1936 par Henri Langlois. Toujours sous statut associatif, la Cinémathèque française est aujourd’hui un opérateur de l’État, sous plafond d’emplois, qui vit essentiellement d’une subvention versée par l’intermédiaire du CNC, d’environ 20 M€ par an et qui représente les trois quarts de son budget (27 M€).
Le rapport, mené sur les exercices de 2016 à 2023, relève des problèmes récurrents, que la Cour avait déjà identifiés il y a dix ans. Sur ses missions de conservation, la Cinémathèque « doit en premier lieu mieux gérer ses réserves, croissantes, dispersées, coûteuses et insuffisamment sécurisées ». La Cour pointe un manque de stratégie immobilière en général et l’urgence à mettre en sécurité des collections de films anciens, sujets à des risques d’incendie.
En deuxième lieu, la fréquentation de la Cinémathèque reste insuffisante et plutôt en diminution, que ce soit pour les projections (195 605 entrées en 2023), notamment auprès des plus jeunes, des expositions ou du centre de documentation. Si le projet d’antenne à Marseille, dans le cadre de France 2030, vise à élargir le public, il est, selon la Cour, moins prioritaire que la construction vouée à la conservation. De même, « le projet d’un musée national du cinéma à la hauteur de la collection ne peut s’inscrire que dans une réflexion globale sur la rationalisation des lieux de réserves, l’avenir du site de Bercy et le modèle économique de la Cinémathèque ».
Et aujourd’hui, ce modèle est à revoir, notamment face aux enjeux du numérique et au manque de mutualisation avec ses antennes en régions. Si la Cinémathèque est bien gérée, sa dépendance aux subventions publiques « ne l’incite pas à développer ses ressources propres ». Et même si elle respecte au mieux son plafond d’emplois, « on peut s’interroger sur une structure qui compte 26 directeurs et directrices pour environ 200 équivalents temps plein ».
Enfin, la Cour interroge la gouvernance de la Cinémathèque, dont l’indépendance revendiquée est de facto relative depuis soixante ans qu’elle est financée sur fonds publics. Le CNC est davantage un partenaire qu’une véritable tutelle et « rien ne justifie que le ministère de la Culture soit absent du conseil d’administration d’un de ses opérateurs ». Le statut associatif actuel montre un défaut de contrôle, « comme en témoignent des contrats d’objectifs et de performance en trompe-l’œil ainsi que l’absence de stratégie immobilière cohérente ». La Cour suggère d’autres formes juridiques, comme celle d’une fondation reconnue d’utilité publique, et plutôt « un adossement renforcé au CNC, voire une intégration, qui lui permettrait de mener une stratégie de long terme plus adaptée à ses ambitions ».
La Cinémathèque répond
Dans leur réponse, le président de la Cinémathèque française, Costa-Gavras, et son directeur Frédéric Bonnaud, font d’abord remarquer qu’à l’instar de l’ensemble du secteur, la Cinémathèque se relève lentement des répercussions de la crise sanitaire. Ils mettent en avant l’excellente fréquentation enregistrée avant le Covid et les évolutions de l’offre qui ont suivi. « Grâce à cette capacité d’adaptation, la Cinémathèque devrait enregistrer en 2024 une fréquentation en salles de 210 000 visiteurs, avec un taux de remplissage supérieur à 55 %, là où l’exploitation commerciale parisienne présente un taux de 15,3 %, et 140 000 visiteurs pour les expositions. Cela porterait la fréquentation globale annuelle à plus de 400 000 visiteurs, un seuil qui n’avait pas été atteint depuis 2013. »
Sur ses collections, qu’elle doit numériser, elle fait face à l’évolution constante du volume, dont le non-film, provenant principalement de donations, et pour lequel elle n’a pas de véritable budget d’acquisition. Le problème historique des lieux de conservation « n’est toujours pas réglé faute de moyens », et sur la création nécessaire d’un Musée national du Cinéma, ils estiment que le débat doit s’ouvrir au plus haut niveau de l’État.
Sur sa situation financière, la Cinémathèque a maîtrisé ses dépenses d’exploitation et su faire évoluer ses recettes propres de 8,7 % sur la période. Pour ses dirigeants, « il est difficile de remettre en question les missions statutaires de la Cinémathèque sur la seule base de leur modèle économique, d’autant plus en tenant compte de la mission de service public de l’institution ».
Le statut associatif de la Cinémathèque française est, de leur point de vue, une force, et la modernisation prochaine des statuts permettra de réfléchir à la place de l’État au sein du conseil d’administration et à la répartition des compétences avec le CNC. « Néanmoins, nous devons alerter avec force sur le fait qu’une intégration complète de la Cinémathèque au sein du CNC entraînerait des conséquences néfastes pour nos collections », notamment vis-à vis d’ayants droit qui, « pour certains, ne souhaitent pas déposer leurs œuvres dans le giron de l’État ».


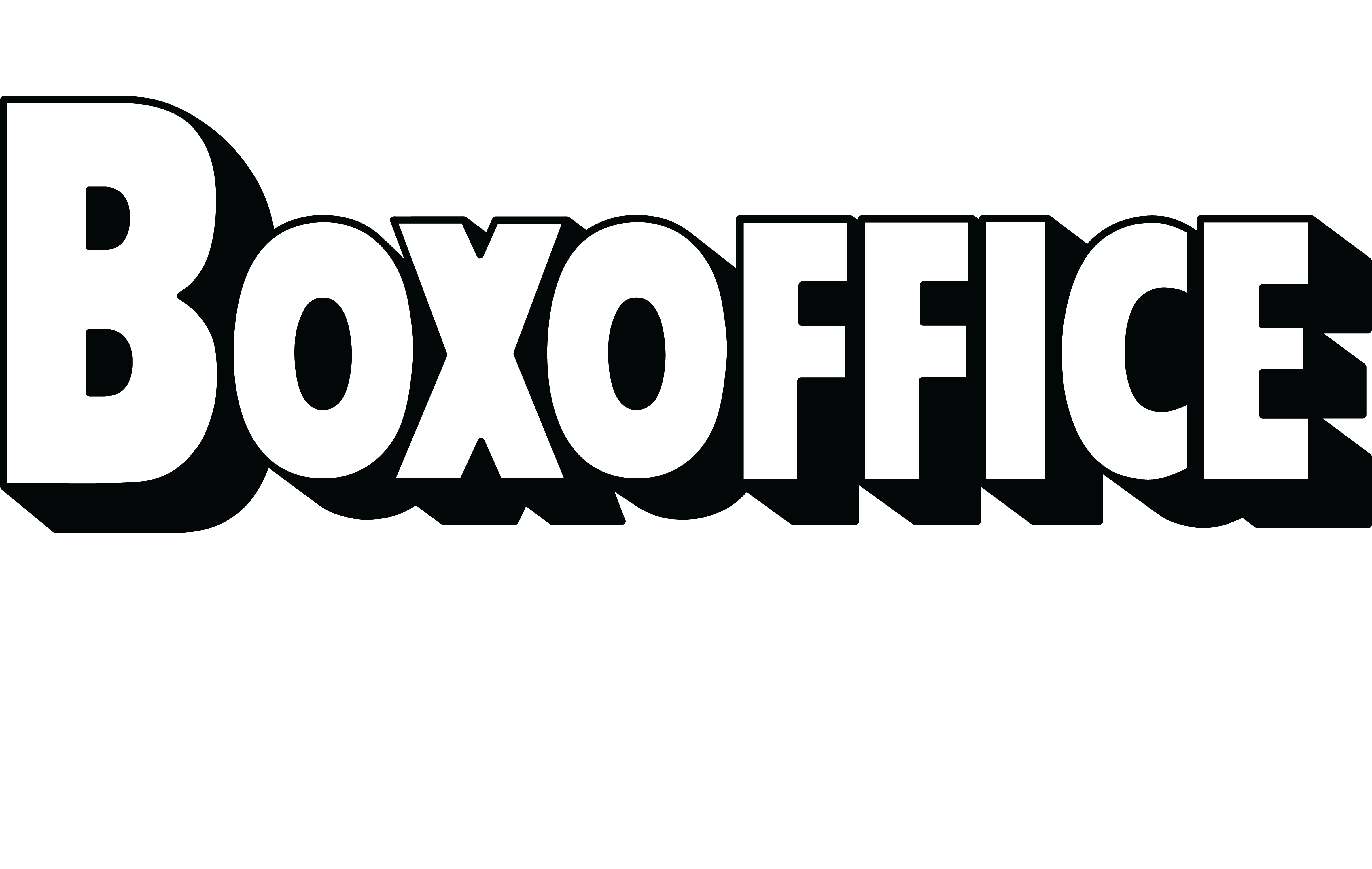
Partager cet article