Revenir sur les 70 ans de l’Afcae revient à retracer 70 ans du mouvement art et essai, créé au départ pour défendre les films “d’avant-garde”, et qui représente aujourd’hui plus de 60 % des cinémas français, et plus de la moitié des films. L’association, née de ce mouvement, a contribué à le faire grandir au fil des évolutions du secteur, en s’inscrivant dans un marché, mais en gardant toujours ses trois objectifs fondateurs : le soutien au cinéma d’auteur, la défense du pluralisme des lieux de diffusion et la formation des publics.
Un mouvement né dans la cinéphilie des années 20
Le mouvement art et essai s’inscrit dans une tradition française de cinéphilie, apparue dès les années 1910 mais, surtout, dans l’effervescence des années folles, avec les débuts de la critique – Elie Faure, Blaise Cendrars, ou des cinéastes théoriciens comme Abel Gance et Germaine Dulac – et, déjà, des salles parisiennes qui défendent des auteurs singuliers, en opposition au cinéma commercial. Des figures comme Jean Tedesco – qui en 1924 ouvre le premier “cinéma d’avant-garde” au Théâtre du Vieux Colombier – et Armand Tallier – en 1926 avec le Studio des Ursulines – ont ainsi joué un rôle-clé. L’ouverture de
de la Cinémathèque française en 1936, avec l’idée que les films doivent être transmis, puis la création du Festival de Cannes en 1939, initiée par Jean Zay, alors ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, pour s’opposer à celui de Venise et de Mussolini, sont des étapes importantes. Vient ensuite la création du CNC en 1946, d’abord pour reconstruire le parc de salles endommagé par la guerre, puis lancer un fonds de soutien pour la production et l’exploitation. La notion d’art et essai se forge dans les années 50 avec des revues comme Les Cahiers du Cinéma ou Positif, et des ciné-clubs qui programment des films de pays inconnus et de patrimoine. C’est dans ce contexte que va naître l’Afcae.
La pionnière Simone Lancelot
Parmi les fondateurs de l’Afcae, Simone Lancelot fait ses débuts “au cinéma” en 1934, au Montcalm (aujourd’hui disparu) dans le 18e arrondissement parisien. Elle y est ouvreuse, caissière, secrétaire et… programmatrice. Elle travaillera par la suite au Barbès Palace et au Ciné Vox, puis au Studio de l’Etoile qu’elle va diriger, où elle programme des œuvres soviétiques ou des films d’animation tchèques. En 1955, elle fait partie des exploitants français qui se rendent à Wiesbaden pour la création de la Cicae, et fondent quelques mois plus tard l’Afcae. L’exploitante s’est aussi essayé à la distribution, avec Les Films du Marais, et n’a jamais raté une édition du Festival de Cannes, où elle faisait en outre partie du comité qui a permis les sélections, en 1973, de La Grande Bouffe de Marco Ferreri et La Maman et la Putain de Jean Eustache. Sa fille Martine avait relaté son parcours professionnel dans Le Cinéma de maman, réalisé en 2012. L’exploitante pionnière, restée membre d’honneur de l’Afcae jusqu’à sa disparition, en 2023 à l’âge de 107 ans, en avait consacré 80 au cinéma.

La création de l’Afcae
En 1950, l’Association française des critiques de cinéma (AFCC) ouvre un “cinéma d’essai”, Les Reflets, et se rapproche des autres exploitants parisiens spécialisés pour se fédérer. Mais c’est en Allemagne, en 1955, que le coup d’envoi est lancé, quand des exploitants européens se rassemblent, sur l’invitation de la jeune AG Kino-Gilde (l’association allemande des cinémas d’art), et créent la Cicae. Dans la foulée, cinq exploitants parisiens créent l’Afcae, avec des critiques (Jean de Baroncelli du Monde, Jeander de Libération). Les Ursulines, Les Agriculteurs, Le Studio Parnasse, Le Cardinet et le Studio de l’Étoile, sont rejoints l’année suivante par le Studio 28, la Pagode, le Panthéon, le Ranelagh, le Studio Bertrand et les Reflets, puis les premières salles de la banlieue parisienne, dont l’Alcazar de Jean Lescure à Asnières. Peu à peu des cinémas en régions adhèrent, d’Aix-en-Provence à Strasbourg en passant par Caen ou Toulouse.
« Si nos goûts et préférences nous portent vers des œuvres originales et hardies, notre groupement ne s’embarrasse d’aucune esthétique préconçue, ne prône aucune formule, ne s’inféode à aucune chapelle », déclare Armand Tallier, premier président d’honneur de l’Afcae, lors de la première AG à Cannes, en 1957. Et s’il s’agit de défendre des films différents, « nous ne méconnaissons pas la nécessité d’un cinéma commercial, et si nous voulons être l’aile marchante, l’avant-garde de nos confrères, nous ne voulons pas perdre le contact avec eux ».
“Si nos goûts et préférences nous portent vers des œuvres originales et hardies, nous ne voulons pas travailler uniquement pour une soi-disant élite”
Armand Tallier en 1957
D’ailleurs, le cinéma relève alors du ministère de l’Industrie et du Commerce. Mais en 1959, De Gaulle crée le ministère des Affaires culturelles, auquel le CNC est rattaché. Sous l’impulsion d’André Malraux, premier ministre de la Culture, conseillé par son ami poète, résistant et exploitant Jean Lescure, les cinémas art et essai sont reconnus par l’État et vont bientôt bénéficier d’aides spécifiques sur des critères de programmation : films innovants, classiques et cinématographies peu diffusées. La première commission de classement art et essai se tient le 9 janvier 1962 : 50 salles sont classées, dont la moitié à Paris.
Des années 60 à 90, avec le bâtisseur Jean Lescure
Dans les années 60, le réseau va s’étendre progressivement, favorisé par les aides du CNC. Mais l’Afcae reste encore très liée au “milieu parisien” et aux fortes individualités de certains de ses fondateurs. Les critiques Roger Régent et Jeander, qui ont été les premiers présidents, veillent à ce que le nombre de salles classées n’augmente pas trop, pour ne pas dénaturer le mouvement. L’arrivée de Jean Lescure à la tête de l’association, en 1966, marque un tournant. Il va plaider pour assouplir les critères afin d’accueillir davantage de cinémas, et après 1968, le parc art et essai comptera davantage de salles en régions que dans la capitale. Cela va constituer la base d’un réel marché du cinéma art et essai, d’autant plus nécessaire que le secteur commence à se concentrer dans les années 70 dans les mains de quelques circuits, en même temps que se développent des complexes dans les grandes villes. Le travail d’animation des cinémas est reconnu, mais indépendamment de leur classement art et essai : à partir de 1979, les salles petites ou moyennes peuvent bénéficier d’une “Prime d’encouragement à l’animation”.
Jean Lescure
L’emblématique président de l’Afcae, de 1966 à 1992, était d’abord écrivain, poète et scénariste français. Né en 1912 à Asnières-sur-Seine, où ses parents avaient transformé leur salle de bal en cinéma, l’Alcazar, Jean Lescure a suivi des études de philosophie et de psychopathologie, et, après de nombreuses collaborations littéraires, a publié en 1939 son premier recueil de poèmes, Le voyage immobile. Résistant pendant la guerre, proche de l’intelligentsia de l’époque – ami de Jean Giono, de Queneau ou Bachelard –, il sera aussi exploitant, en s’associant à son père en 1956 pour diriger l’Alcazar, dont il fait l’une des premières salles de banlieue consacrée à l’art et essai. Avec André Malraux, rencontré en 1944, il prépare les conditions du classement art et essai, avant de devenir président de l’Afcae. Il présidera également la Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai (Cicae), sera le conseiller privé du président de l’INA… tout en restant un écrivain et auteur important, notamment honoré du Grand Prix Poncetton de la Société des gens de lettres, en 1992, pour l’ensemble de son œuvre. Jean Lescure s’est éteint en octobre 2005 à Paris, à l’âge de 93 ans.

Les années 80 à 90 sont marquées par une crise de la fréquentation et de nombreuses fermetures de salles, mais aussi des décisions politiques marquantes. L’arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture en 1981, ainsi que la politique générale de décentralisation vont renforcer la protection des cinémas, avec l’idée que la culture doit irriguer le territoire. Sur la même année 1983, sont ainsi créés l’ADRC, le Médiateur du cinéma, mais aussi les règles de la chronologie des médias. Le soutien du CNC, la prise de conscience et l’engagement des collectivités, et les nouvelles stratégies des professionnels vont accélérer la rénovation privée et publique du parc de salles. L’arrivée des multiplexes dans les années 90 redynamise la fréquentation en général et si les salles art et essai sont menacées, elles vont continuer à se développer et, finalement, bien résister, grâce au lien fort avec leur public, leur programmation et leur travail d’animation. En 1990, 922 salles sont classées, soit environ 20 % du parc. L’Afcae participe à cette dynamique et renforce ses actions entre adhérents, avec le lancement du Courrier de l’Art et Essai en 1991, des Rencontres nationales de Cannes en 1992, puis des rencontres Jeune Public et Répertoire.
En 1992, Jean Lescure laisse sa place de président à Philippe Paumelle, président de la Soredic. Les dispositifs nationaux d’éducation à l’image se mettent en place – avec École et cinéma en 1994 – et, pour le nouveau président, « ouvrir les portes des salles de cinéma aux enfants est sans doute l’un des meilleurs investissements qui puisse être fait, non seulement pour la formation de ceux-ci, mais aussi pour l’avenir du cinéma ».
Chronologie d’un classement
1955 : création de l’Afcae (5 salles)
1959 : reconnaissance du mouvement par l’État
1962 : mise en place du classement art et essai
2002 : réforme du classement art et essai
2017 : réforme de “simplification et modernisation”
2024 : nouvelle réforme du classement
Un parc florissant
1962 : 50 salles classées (environ 1 % du parc)
1980 : 623 salles classées
1990 : 922 salles classées (environ 20 % du parc)
2000 : 1 130 salles classées
2020 : 1 248 cinémas classés
2024 : 1 292 cinémas classés (62 % du parc)
Le passage à l’an 2000… et à l’équipe Brouiller
Élu président de l’Afcae en 1994, Patrick Brouiller, exploitant en périphérie parisienne, prend le relais avec une nouvelle équipe – notamment Xavier Blom (Les Sept Parnassiens à Paris), Alain Bouffartigue (Ciné 32 à Auch) et Alain Nouaille (le Sémaphore à Nîmes), piliers du Conseil d’administration pendant 21 ans. Ils vont renforcer l’accompagnement des films et inciter à les programmer, en créant les groupes Action promotion, Patrimoine et Jeune public, ce dernier développant particulièrement le travail vers les 3-12 ans.
Les années 2000 sont marquées par l’arrivée des cartes illimitées et une concentration du secteur qui s’accentue (fusion Pathé/Gaumont, etc). Alors que les grands circuits se diversifient en programmant les films recommandés porteurs, la carte illimitée lancée par UGC en 2000 apparaît comme un nouveau symbole de la concurrence. L’Afcae et l’Arp (Société des auteurs, réalisateurs, producteurs) – créée en 1994 – sont en première ligne et vont obtenir, en 2001, que les cartes soient acceptées chez les indépendants.

La première grande réforme de l’art et essai arrive en 2002. Désormais, le classement s’établira non plus par écran mais par établissement, pour ne pas favoriser les plus gros, prendra mieux en compte la situation géographique et socio-culturelle d’un cinéma et, surtout, son travail d’animation, au-delà du critère quantitatif de programmation.
Dans les années 2010, le passage au numérique, qui va imposer de gros investissements techniques, interroge la régulation du secteur. L’Afcae contribue à la réflexion à travers le Collectif des indépendants pour le numérique, sur les VPF et pour que la transition se fasse dans l’intérêt général. « Nous serons très vigilants sur le fait qu’elle ne doit pas aboutir à un phénomène de concentration supplémentaire », alerte Patrick Brouiller en mai 2011. Cette année-là, la table-ronde des Rencontres de Cannes s’intitule : « Face aux logiques de concentration : pour préserver la diversité, quelles politiques de régulation ? ».
L’Afcae sera ensuite auditionnée dans le cadre du rapport Lagauche sur l’aménagement cinématographique, puis, dans la foulée des “Assises pour la diversité du cinéma français”, du rapport Bonnell de 2014, qui va influencer la prochaine réforme de l’art et essai.
La réforme de 2017, et les années Aymé
En 2015 à Cannes, le renouvellement du conseil d’administration de l’Afcae et l’élection de François Aymé, exploitant à Pessac, marque un net rajeunissement.

Leur premier gros chantier est celui de la réforme art et essai en cours, qui sera adoptée en 2017. Elle instaure une valorisation financière des labels (JP, Patrimoine, Recherche), un bonus pour les établissements de 1 à 3 écrans, ainsi que pour ceux qui programment des films de recherche et des courts métrages. Le classement se fera désormais sur deux ans, et les films seront recommandés a priori (avant leur sortie). Sur ce point, l’Afcae est chargée de gérer la plateforme de visionnement des films.
Par ailleurs, l’environnement est en train de changer : Netflix est arrivé en France en 2014, et le renouvellement du public est une priorité pour les cinémas art et essai. Cela passe d’abord par le rajeunissement de leur image et celle de l’association, qui modernise toute sa communication, notamment numérique. L’équipe de permanents est renforcée, et contribuera à lancer des actions comme la création d’un lieu de rencontres à Cannes, le Festival Télérama Enfants, le prix Jean Lescure, la Journée Européenne du cinéma art et essai avec la Cicae, mais aussi le Prix des cinémas art et essai à Cannes ou les avant-premières coup de cœur surprise en 2020… Cela participe d’une communication renforcée dans les médias, mais aussi en interne – avec notamment des formations live pendant la pandémie, organisées avec Boxoffice Pro – et au sein du secteur – avec un premier stand au Congrès de Deauville en 2016.
Il s’agit aussi de sensibiliser une nouvelle génération d’élus locaux et nationaux. L’Afcae va entre autres militer pour le financement de postes de médiateurs culturels, une façon de renforcer le travail d’éducation à l’image et, plus largement, auprès des publics jeunes. Dans le contexte de la crise sanitaire, l’association se mobilise pour la création d’un fonds Jeunes cinéphiles, et agrandit son équipe pour travailler en direction des 15-25 ans et des étudiants.
“Les actions de médiation, d’éducation au cinéma, de coopération territoriale sont au cœur de nos engagements”
Guillaume Bachy en 2025
Et aujourd’hui…
En 2022, Guillaume Bachy, directeur des Cinémas du Palais à Créteil, devient président de l’association, où il a été entre autres responsable du groupe Jeune public pendant cinq ans. Et là encore… l’Afcae travaille sur la nouvelle réforme art et essai, qui s’appuie en particulier sur le rapport de Bruno Lasserre rendu en avril 2023 et mise en œuvre cette année. Comme les précédentes, la réforme s’inscrit dans une logique incitative, qui veut que plus le travail augmente, mieux les salles sont récompensées. Une logique qui, en 70 ans, a motivé une évolution structurelle de l’art et essai, avec de plus en plus de salles classées, qui aujourd’hui représentent donc la majorité des cinémas français. Jusqu’à présent, l’enveloppe art et essai du CNC a suivi cette évolution – sur les 15 dernières années, elle est passée de 11 M€ à 19 M€. Reste à savoir si elle sera réévaluée en 2025, comme le demande l’Afcae.

Le nouveau classement prend notamment en compte les actions en direction des 15-25 ans, un travail que l’Afcae a accentué ces dernières années, y compris en partenariat avec le pass Culture, un outil qu’elle avait au départ accueilli avec réserve. Aujourd’hui, son action en direction des publics jeunes est d’autant plus primordiale que les dispositifs d’éducation aux images sont menacés. Mais les salles art et essai, qui incarnent particulièrement le maillage territorial – un cinéma classé sur deux est dans une petite ville –, doivent s’adresser à tous, en s’affirmant comme des lieux de rencontres, vivants et qui vont de l’avant. « Nous souhaitons initier une réflexion collective pour moderniser l’image de notre mouvement », énonce Guillaume Bachy à la veille de ces Rencontres cannoises 2025.



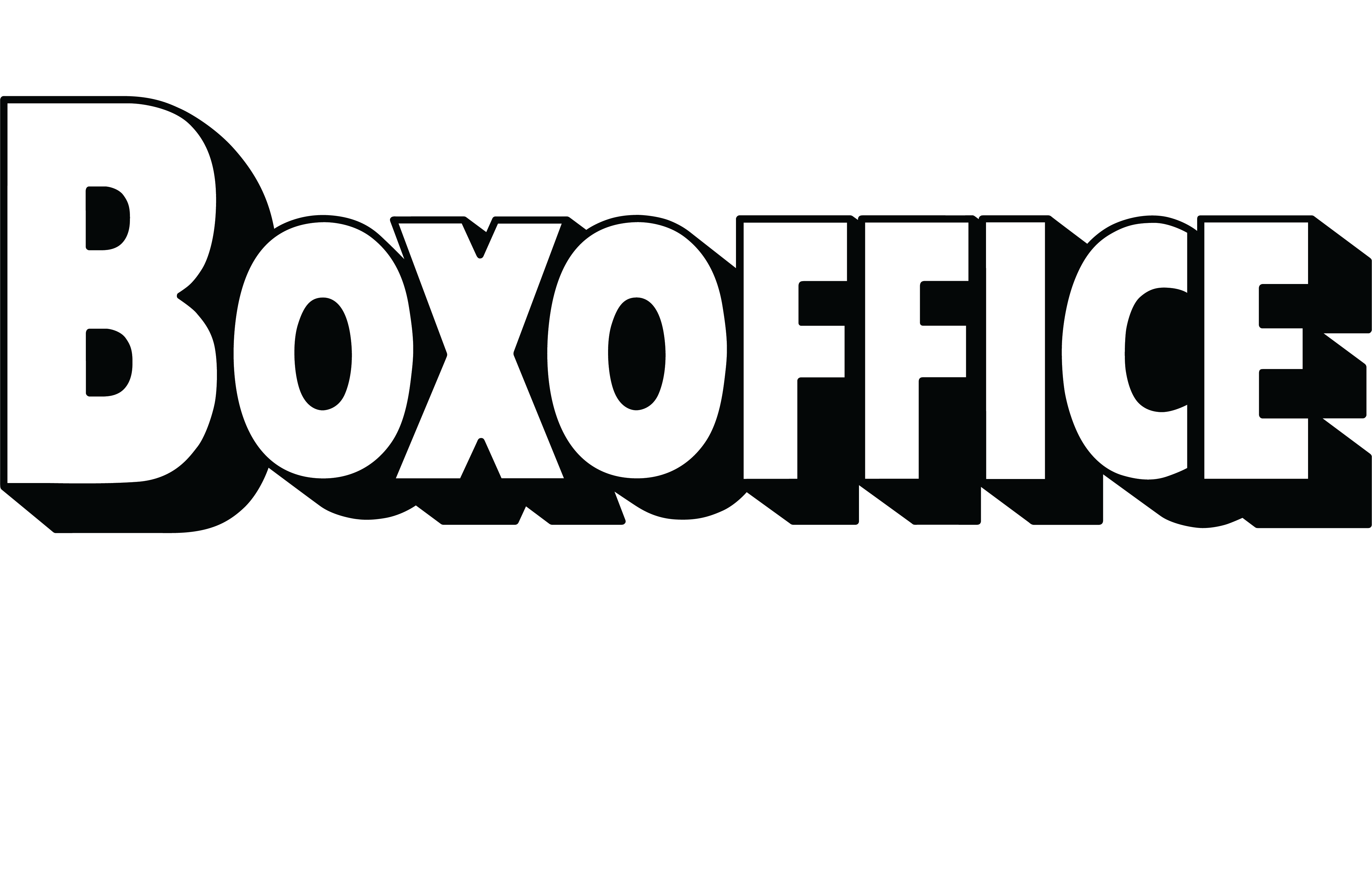
Partager cet article