Le Marché international du film classique (MIFC) organisé depuis 12 ans dans le cadre du Festival Lumière, à Lyon, ouvre ses portes aujourd’hui, et s’ouvre de plus en plus aux exploitants. Retour sur les évolutions et les enjeux de la diffusion du cinéma de patrimoine, en compagnie de la directrice du MIFC Juliette Rajon.
Article paru dans le Boxoffice Pro du 9 octobre 2024.
Depuis 2013, le MIFC représente le premier et unique marché du film classique au monde. Objectivement, qui “fait” ce marché ?
Nous accueillons tous les maillons de la chaîne, des ayants droit et catalogues à l’ensemble des diffuseurs : les distributeurs en salles, les salles de cinéma, les chaînes TV, les services SVOD et les éditeurs de vidéo physique. Les laboratoires sont aussi très présents, tout comme les archives et bien sûr les cinémathèques. En résumé, tous les acteurs qui œuvrent sur la conservation, la circulation et la diffusion d’œuvres de patrimoine.
Avant de parler de la salle, comment se porte le “répertoire” dans le segment de la vidéo physique ?
Dans ce marché en souffrance depuis le développement de tous les autres médiums de consommation d’image, les films de patrimoine s’en sortent mieux que les inédits. D’autant plus que beaucoup de titres n’existent pas sur d’autres supports. Donc, même s’il n’est plus aussi florissant qu’il y a 30 ans, il y a toujours un marché de l’édition physique, comme le prouve le succès du salon du DVD dont nous organisons la 6e édition ce dimanche 13 octobre, au village du MIFC.

Nous sommes très fiers de proposer ce moment qui met en valeur toutes ces belles éditions collector et coffrets. C’est un rendez-vous qui, certes, permet aux éditeurs de faire “du chiffre” et de nourrir leur base de données clients, mais surtout de rencontrer leur public, d’échanger sur leurs lignes éditoriales.
En parlant d’échanges, comment les nouveaux acteurs de la SVOD se sont-ils intégrés au MIFC ?
Ils sont bien entendu tous conviés, et notamment à nos discussions, auxquelles participent régulièrement les plateformes spécialisées comme Mubi, la Cinetek, Universciné… Mais nous avons du mal à faire prendre la parole aux grosses plateformes généralistes internationales, telles que Netflix, Amazon, ou plus récemment Max de Warner Bros. Discovery, qui ne saisissent pas l’occasion pour promouvoir et défendre leur ligne éditoriale et leurs actions en faveur du patrimoine, partager leur stratégie et leur vision du secteur. Nous avons bon espoir d’y parvenir prochainement !
Le “répertoire” n’a-t-il pas par ailleurs prouvé, notamment depuis la crise sanitaire, qu’il avait plus que jamais sa place dans les salles de cinéma ?
2023 promet d’ailleurs de battre un nouveau record en matière d’entrées pour le cinéma de patrimoine. Oui, désormais, la donne a changé. D’une part parce que l’actualité du cinéma “frais” incite parfois à trouver des compléments de programmation. D’autre part parce que les exploitants savent mettre en place des actions autour de ces séances et trouver un public, qui a lui-même redécouvert le patrimoine, notamment au moment du confinement. Et nous, à l’Institut Lumière, nous ne pouvons que nous réjouir de la place qui est faite aux classiques dans les salles, qui restent le plus bel écrin pour les découvrir.
D’où le partenariat de longue date du MIFC avec l’Afcae et l’ADRC ?
Ce partenariat remonte quasiment à la naissance du Festival, en 2009, et se noue dans le cadre du Marché depuis 2015. Le rapprochement était d’autant plus naturel que l’Afcae comme l’ADRC ont toujours été extrêmement dynamiques dans la promotion du patrimoine en salles. En l’occurrence, le Festival Lumière, qui est à l’initiative de beaucoup de restaurations et ressorties, de choix de thématiques et de rétrospectives, fonctionne comme une caisse de résonance, donnant de l’élan à leur exploitation ultérieure dans d’autres lieux. Les centaines de spectateurs qui viennent redécouvrir les films à Lyon, sans compter la presse nationale et internationale, sont autant de supports que les salles peuvent utiliser dans leur propre travail d’accompagnement des films et d’irrigation du territoire.
D’ailleurs, tous les ans vous organisez au moins une table ronde autour d’une thématique exploitation…
L’animation des séances de patrimoine, les outils marketing ou encore, l’interaction entre les salles sont autant de sujets “de terrain” que nous avons déjà abordés, en prenant soin d’inclure un exploitant étranger pour élargir le partage d’expérience. Cette année, nous explorerons les “stratégies et leviers pour une exposition accrue du cinéma de patrimoine en salles”. Par ailleurs, une étude de cas sera consacrée à la place du patrimoine dans les festivals et ses effets bénéfiques sur l’exploitation.
La diffusion du cinéma de patrimoine doit toujours être accompagnée d’un travail éditorial en phase avec son temps.
Juliette Rajon, directrice du MIFC
Cette année, nous retrouvons aussi, après un an d’arrêt, le “rendez-vous des distributeurs et des exploitants” pour des présentations de line-ups. Enfin, outre le parcours qui leur est dédié, toutes les autres tables rondes du marché peuvent intéresser les exploitants. Car au-delà de leurs angles plus ou moins techniques, juridiques, politiques, sociologiques… elles ont toutes pour objet, et ce quelque soit le support, le spectateur et sa réception des œuvres.
Quelles nouvelles collaborations avez-vous prévues sur cette édition 2024 ?
Cette année, la FNCF interviendra pour la première fois au MIFC, à un moment où la réforme de l’art et essai peut amener à questionner les enjeux de la diffusion du patrimoine en salles. Nous accueillerons aussi la Cicae et l’Unic pour aborder le sujet à travers une vision européenne et extra européenne. Bien que les expériences de terrain soient primordiales, il est important de les questionner aussi d’un point de vue politique et stratégique.
Comparée aux autres territoires, la France est-elle un terrain particulièrement fertile pour la diffusion du cinéma de patrimoine ?
Justement, cette année, nous allons pouvoir dresser des comparaisons concrètes. Il est vrai que le cinéma de patrimoine est très aidé en France, notamment à travers les aides à la restauration du CNC. Nous disposons d’un secteur très structuré, composé de beaucoup de professionnels, des départements patrimoine des grands groupes – comme Studiocanal, Pathé, Gaumont –, aux indépendants spécialisés – comme Malavida, Carlotta ou Tamasa. Et ceci sans compter le réseau de cinémathèques et de salles engagées. Objectivement, au MIFC, il y a une sur-représentativité des acteurs français, qui représentent 70 % des participants.
Pour autant, et bien qu’elles ne disposent pas de groupes dédiés, l’Unic et la Cicae sont impliquées dans la diffusion patrimoine dans les territoires où elle bénéficie moins de soutien public, mais où elle est portée par des exploitants extrêmement dynamiques. C’est toute la puissance du collectif, et nous avons hâte de les accueillir, tout comme de recueillir leurs datas, notamment sur le nombre de salles spécialisées ou le nombre de sorties répertoire. Nous continuons par ailleurs notre travail en destination des acheteurs de cinéma de patrimoine vers l’international ; ceux-ci se renouvellent désormais tous les ans et de nouveaux entrants se positionnent au MIFC, ce qui est un de nos buts : aller vers toujours plus d’internationaux.
Enfin, en écho à un sujet qui mobilise les exploitants français, pouvez-vous nous dire un mot des engagements écologiques et sociétaux du MIFC ?
Notre Marché est soutenu par le programme Media d’Europe Creative, et à ce titre, il est tenu de s’engager dans une démarche écoresponsable. Ce que nous faisons, tant dans notre organisation logistique – réduction de consommation d’énergie, rationalisation du fret, limitation de l’impression papier et de la vaisselle jetable… – que dans notre éditorialisation, comme une précédente table ronde où nous avions abordé la question de la conservation et du stockage responsables, ou encore lors d’ateliers menés avec Relais Culture Europe. Mais notre responsabilité est aussi sociétale. C’est pourquoi, cette année, une de nos tables rondes sera consacrée au traitement du cinéma classique à l’heure des changements de paradigmes.

Nous ne pouvons pas rester à l’écart des questions que soulève la représentation des minorités dans le cinéma, ou des réalisateurs dont les méthodes de travail ou les relations ont été, a minima, dénoncées. Aujourd’hui, certains films peuvent en effet paraître “à côté de la plaque”, mais doit-on pour autant les bannir de toute diffusion ? Le but n’est pas de polémiquer ni de prendre parti, mais de réfléchir aux bons outils d’accompagnement, pour concilier la diffusion de ces œuvres avec un nouveau regard. Le patrimoine est un éternel réservoir en développement, parce que les films d’aujourd’hui deviennent le cinéma de patrimoine de demain. Au-delà des questions techniques, juridiques et économiques qui peuvent se poser, leur diffusion doit toujours s’accompagner d’un travail éditorial, en phase avec son temps.
À lire aussi │ Festival Lumière 2024 : L’Afcae et l’ADRC détaillent leurs journées pro


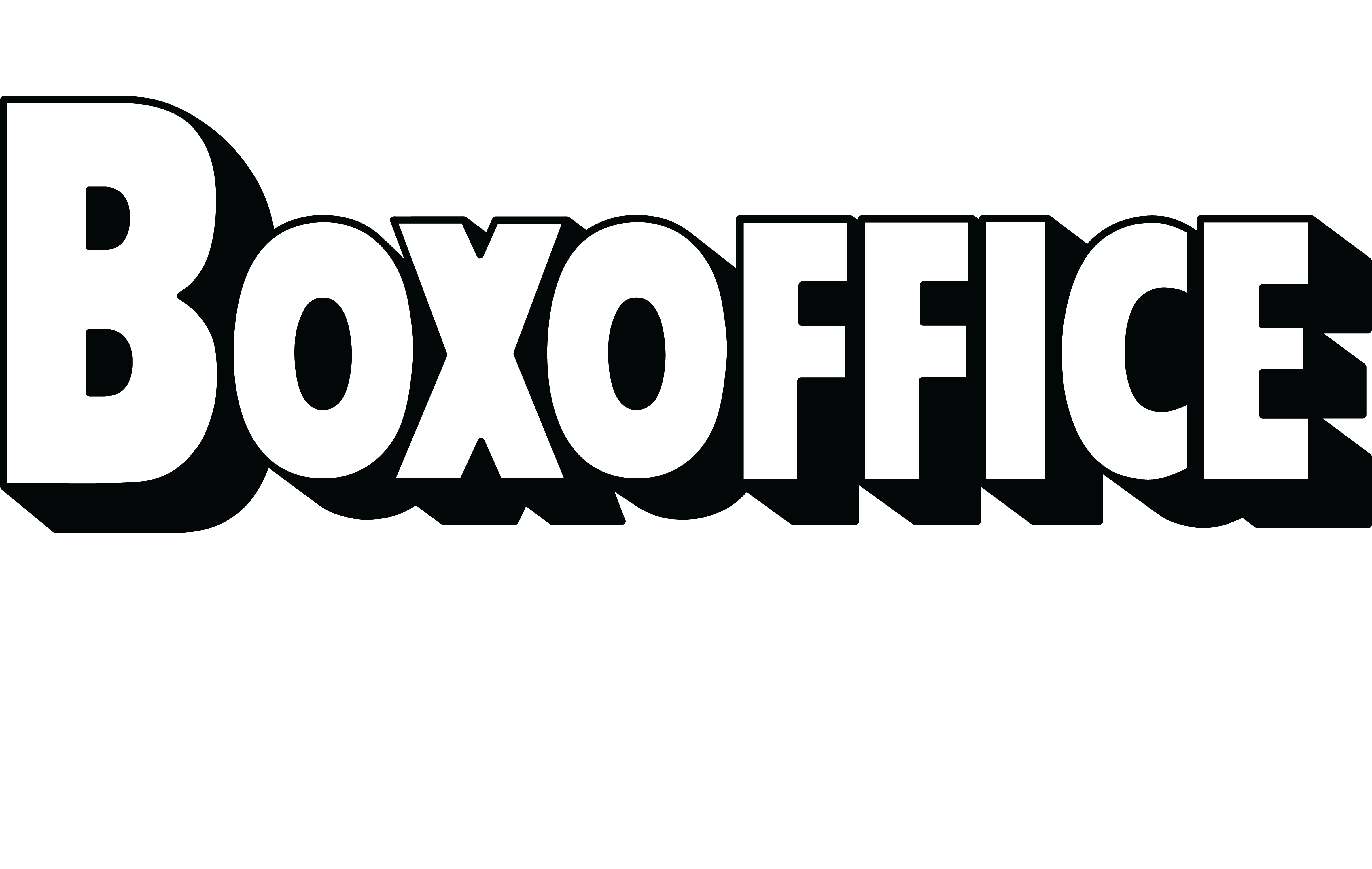
Partager cet article