Lors des Rencontres de l’ARP, Martin Ajdari, président de l’Arcom, a dévoilé l’apport dans la création audiovisuelle et cinéma des différents diffuseurs, lié à leurs obligations de financement.
En 2024, un total de 1,6 milliard d’euros de dépenses ont été retenues, de la part des différents acteurs, au titre de leurs obligations de financement prévues par le décret SMAD (Services de médias audiovisuel à la demande), soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2023. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié son bilan aujourd’hui, que son président a présenté au Touquet.
Les investissements déclarés par les quatre groupes audiovisuels historiques (France Télévisions, TF1, M6 et Canal+) représentent 69 % de la contribution totale, soit 821 M€ (contre 71 % en 2023, soit 846 M€). Pour rappel, Arte n’est pas concernée en tant que chaîne franco-allemande. France Télévisions reste le premier contributeur (35 %) et les SMAD représentent 27 % du total, avec une contribution en hausse de 18 % par rapport à 2023, qui atteint désormais 397 M€ en dépenses retenues. Ce montant « compense la petite baisse venant des télévisions », commente Martin Ajdari. Parmi les plateformes, Netflix est celle qui participe le plus (19 % des dépenses totales déclarées, soit 222 M€).
443 millions d’euros dans le cinéma
Sur la production cinéma, les obligations d’investissement sont passées de 431 M€ à 443 M€ en 2024 (+2,8 %), une hausse portée principalement par les plateformes. En effet les dépenses des éditeurs linéaires sont stables avec 363 M€, quand les SMAD passent de 71 M€ à 80 M€ (+13 %). Pour le président de l’Arcom, « cette progression illustre le succès de l’intégration de ces acteurs étrangers dans notre écosystème ».
Les nouveaux acteurs du streaming ont consacré 89 % de leurs investissements dans des oeuvres françaises, 78 % à des films inédits et 67 % à la production indépendante. « Ils respectent les obligations du décret SMAD et vont même un peu au-delà : les grands marqueurs de notre exception culturelle ont été préservés, et selon Martin Ajdari, le bilan est plutôt positif, même si des tensions demeurent. »
On sait notamment que le cas d’Amazon est spécifique, car son chiffre d’affaires sur la seule vidéo est difficile à cerner. Depuis 2021, un forfait a été établi pour considérer que 30 % de son chiffre était attribuable à son offre vidéo, un mode de calcul toujours contesté par la plateforme.
Perspectives pour 2025… et 2026
Pour cette année, le président de l’Arcom estime que le niveau d’obligation sera stable, « avec peut-être un petit repli sur le cinéma lié à la diminution des engagements de Canal+, pas encore compensée par d’autres accords, notamment avec Disney ».
Le retournement risque d’avoir lieu en 2026, à cause de la baisse d’audience de la télévision linéaire et de la baisse de ses revenus publicitaires (-5 % en 2025), et la diminution du budget de France Télévisions, « qui va altérer son rôle structurant dans l’écosystème », précise Martin Ajdari. Il pointe aussi que le rythme de progression des abonnements des SMAD va ralentir, et prévoit donc un contexte « moins engageant pour 2026, qui en appelle à une prise de conscience et à un sursaut », tant des pouvoirs publics que des différents acteurs de la filière.


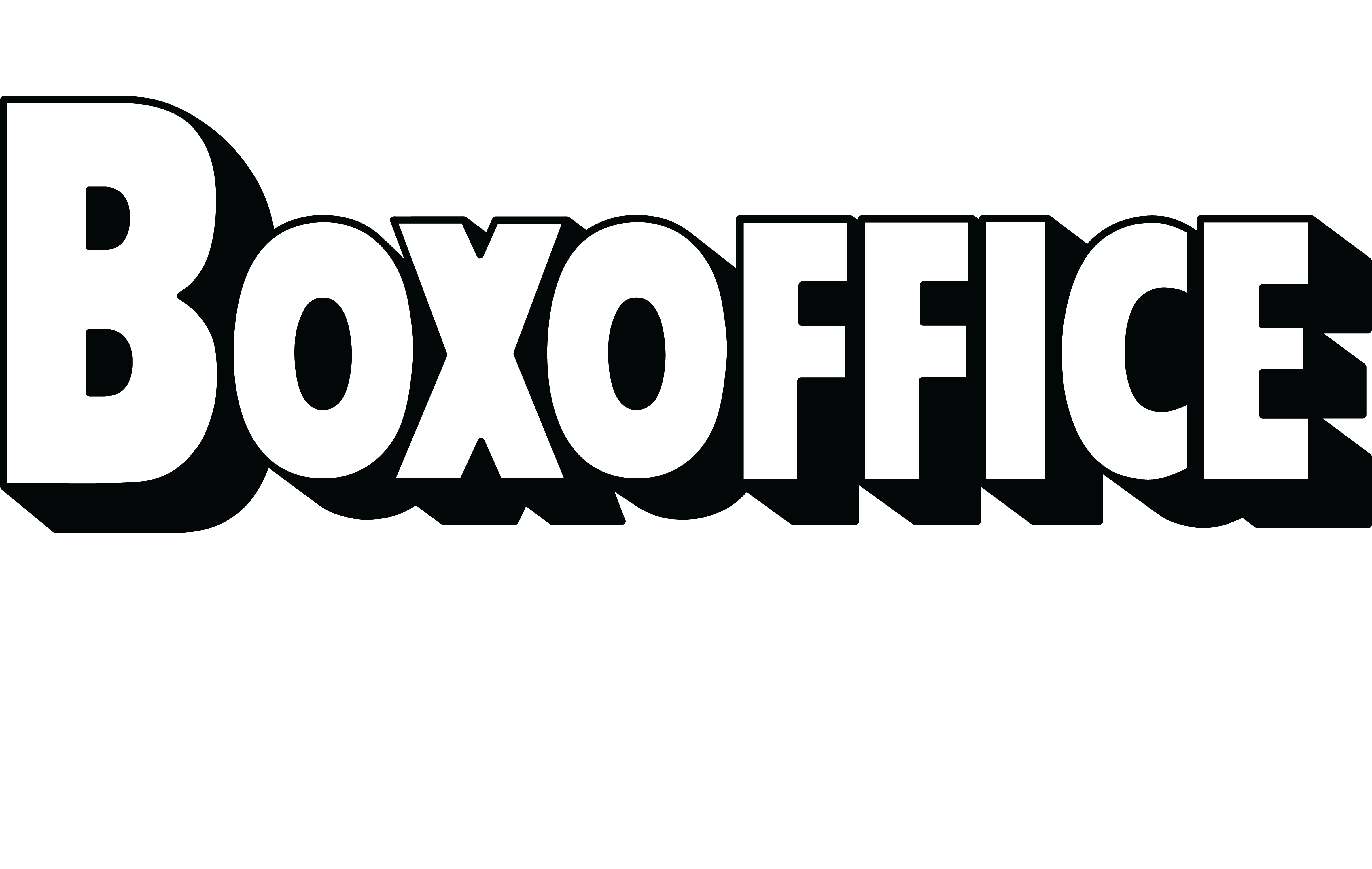
Partager cet article