À l’occasion du 500e numéro – et des 20 ans d’existence – de Boxoffice Pro (ex-Côté Cinéma), la rédaction propose de replonger dans les évolutions de l’exploitation cinématographique de ces vingt dernières années, à travers la plume et la parole d’acteurs ou d’observateurs de la filière. Focus sur les mutations de la projection numérique avec André Labbouz, président de la CST.
Dossier à retrouver en intégralité dans le Boxoffice Pro du 22 septembre 2025
« Quand je montre de la pellicule à mes stagiaires, ils ne savent pas ce que c’est »
André Labbouz, président de la Commission supérieure technique
Le nouveau président de la CST a longtemps été exploitant avant de devenir directeur technique chez Gaumont. À ce titre, il fait le lien entre la production, la distribution et les salles, à la fois témoin et acteur de la révolution numérique de ces vingt (cinq) dernières années.
« J’ai commencé comme bénévole dans un cinéma à Courbevoie, où je faisais des animations autour des films. Puis je suis devenu projectionniste, avant d’avoir mes propres salles de cinéma en tant qu’exploitant, d’abord à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, puis à Gaillac, fin 1982, avec l’aide de l’ADRC », relate André Labbouz. Il entre en 1986 chez Gaumont, dont il devient directeur technique trois ans après, et rejoint alors la CST à titre personnel, d’abord au département Laboratoire, devenu aujourd’hui le département Postproduction. Et pour cause…« Les premiers essais de projection numérique ont eu lieu en 2000 au Gaumont Aquaboulevard, avec Les Rivières pourpres et la technologie développée par Texas Instruments. Quand je suis sorti de la salle, je me suis adressé aux laboratoires et leur ai dit : “Dans 20 ans on est morts”. Je me trompais : c’est arrivé 10 ans après ».
La première projection numérique publique d’Europe a lieu au même endroit une semaine plus tard, le 2 février, avec Toy Story 2. Les premiers équipements des salles commencent en 2007, chez CGR, deux ans avant la sortie de Avatar en 3D, qui marque le grand basculement. « En 2011 le laboratoire LTC ferme, en 2013 le 35 mm a disparu, résume André Labbouz. Aujourd’hui Technicolor n’existe plus, Deluxe n’a plus qu’un labo à Londres… et ceux qui restent emploient entre 10 à 15 personnes contre 150 il y a 20 ans. La révolution numérique a entraîné la disparition d’un savoir-faire et de nombreux métiers : les développeurs, tireurs et chimistes… et raréfié les projectionnistes dans les salles. »
En tout cas, ces derniers n’ont plus de copie lourde à porter, « ce qui a féminisé le métier en cabine »… et évité à André Labbouz, dans ses fonctions chez Gaumont, de transporter parfois 60 kg de pellicule dans un festival. « Mais mon travail de post-production, avec le réalisateur ou le directeur photo d’un film, est resté le même. Les étapes d’étalonnage ou de mixage n’ont pas changé, si ce n’est qu’avec la pellicule, on faisait d’abord une copie 0, puis des vérifications successives avant de tirer l’inter-positif, puis l’inter-négatif, avant la première copie qu’on livrait aux salles, et qu’il fallait encore vérifier. Avec le numérique, une fois qu’on a fini l’étalonnage, on fait le DCP et on a la même qualité tout le temps. » Y compris dans les salles bien sûr, où même 4 semaines après la sortie d’un film, les copies restent intactes, sans rayures, poussière, et autres perfos abîmées…
Pour les distributeurs, la numérisation a techniquement « simplifié l’envoi des copies aux salles » et, du moins en théorie, « permis à des petits cinémas en province de programmer les films plus tôt ». Mais pour André Labbouz, « on fait toujours le même métier, avec moins d’effectifs, l’activité étant désormais centralisée à Paris, après la fermeture des agences de Bordeaux, Marseille ou Lyon, qui étaient liées aux stocks de copies 35 et d’affiches papier ».
Dans les salles, la qualité est là
Cela n’a pas empêché le directeur technique de Gaumont de continuer à sillonner la France des cinémas et festivals, y compris en tant que membre du département diffusion-exploitation de la CST ces 15 dernières années. « Nous avons les plus beaux cinémas du monde, avec des professionnels qui aiment leur métier et une qualité de projection quelle que soit la salle. Même si parfois on aurait envie de monter un peu le son, ou si l’on reste réticents sur les écrans métalliques installés pour la 3D – la CST militant pour garder les écrans blancs, qui offrent une bien meilleure qualité pour le 2K –, tous les opérateurs savent qu’il faut 48 candélas au centre de l’écran, et la qualité est là. C’est la mission de la CST d’y veiller, et pour ceux qui font des efforts particuliers, nous avons créé le label Excellence, auquel de plus en plus de salles sont candidates. »
De façon générale, les missions de la Commission supérieure technique ont évolué, embrassant des problématiques comme l’écologie et l’inclusion, et organisant des formations. Notamment sur la projection, « car le savoir-faire s’est perdu alors que cela reste un métier ». Le 1er juillet, André Labbouz a pris sa retraite… et ses fonctions officielles de président de la CST – succédant à Angelo Cosimano. Et quand on lui demande ce qu’il entrevoit pour son mandat, il s’interroge sur l’opportunité de remettre un CAP de projectionniste en route. « Quand je montre de la pellicule à mes stagiaires, ils ne savent pas ce que c’est ». Or cela reste une compétence nécessaire, sans ignorer tout ce qu’a apporté le numérique. « L’an dernier, lors des répétitions nocturnes à Cannes, un réalisateur qui avait tourné son film sur pellicule est venu avec une copie 35 et une numérique. Sur l’écran du Grand Palais, nous avons projeté 20 minutes dans chaque format : il a préféré le DCP ! Son image 35 était pourtant magnifique, mais nous avons perdu l’habitude de la projection 35, avec des petits problèmes de fixité, de bords arrondis… alors qu’avec un DCP, tout est parfait. »Une propreté qui offre aussi une nouvelle vie aux films restaurés : « C’est extraordinaire de découvrir des classiques qu’on n’avait jamais vus dans cet état », se réjouit celui qui a aussi programmé des cycles art et essai dans les salles Gaumont, bien avant le numérique. « Mais attention, si l’on peut manipuler des films qui ont cent ans, c’est parce qu’ils étaient sur pellicule et ont pu être conservés. Aujourd’hui, je ne sais pas ce que vont devenir les photos que j’ai sur mon téléphone portable : nous n’avons pas la solution pour conserver de façon pérenne les images numériques. Je conseillerais donc à tous les producteurs de tirer de la pellicule… et de la mettre à l’abri. »


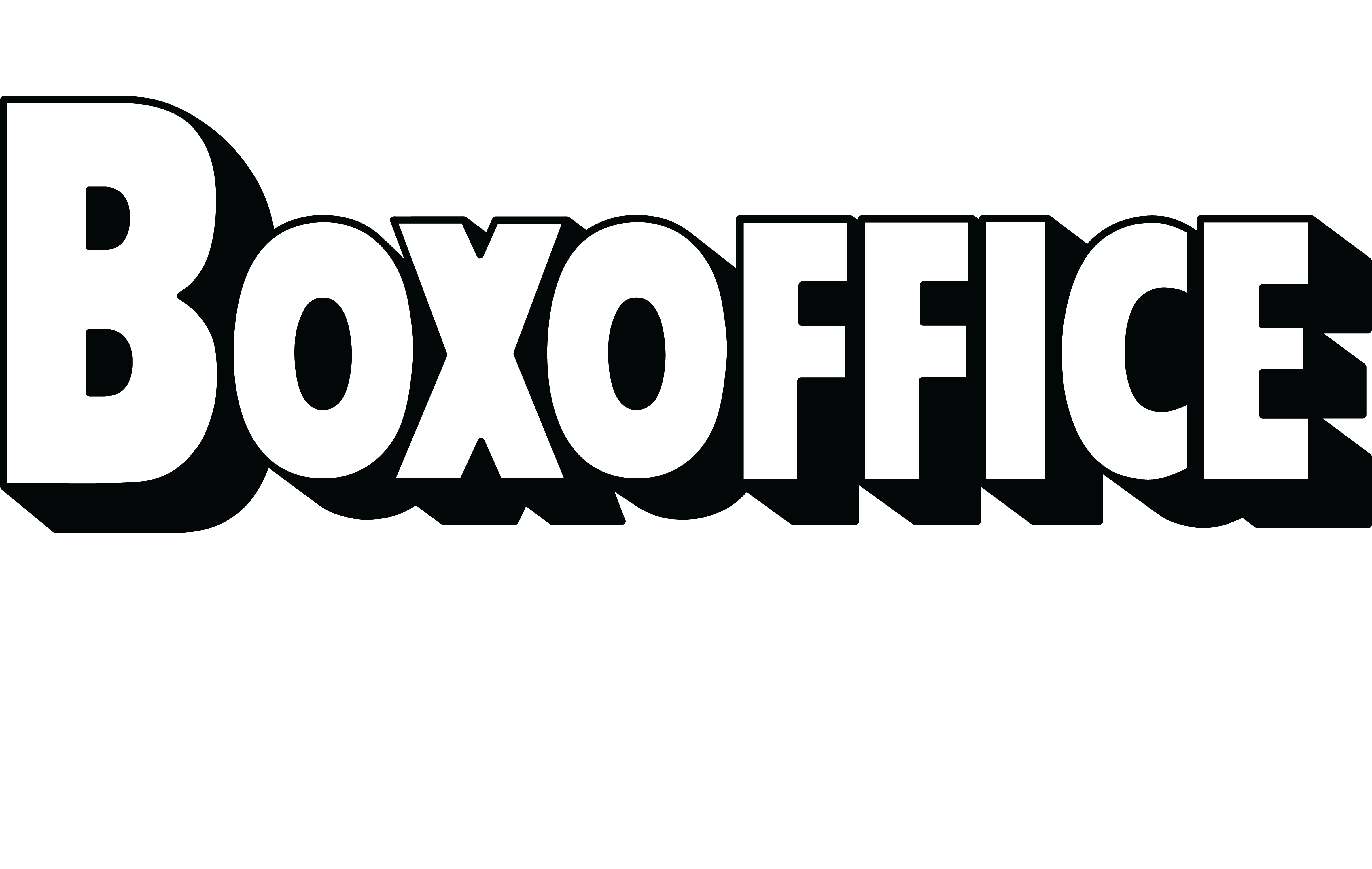
Partager cet article